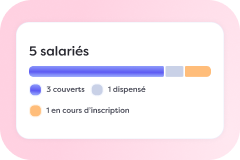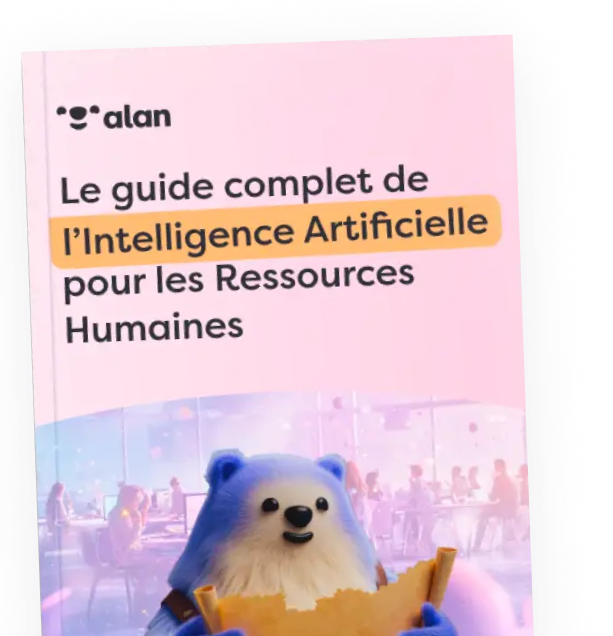Article Preview
Translation Key :
not setHealthier Humanity podcast Épisode 7 Dans les coulisses de l'innovation médicale - Professeur Michel Goldman

Le Professeur Michel Goldman, figure majeure de l'innovation médicale en Europe, nous dévoile sa vision de la médecine du futur. Dans cet épisode, il analyse les transformations profondes de notre approche de la santé à la lumière des leçons de la pandémie COVID-19. La révolution des vaccins ARNm, qu'il qualifie de "véritable révolution qui s'est mise en marche", n'est que la partie émergée d'une transformation bien plus large de la médecine. Écoutez l'épisode ici 👇 🎙️Spotify 🍎Apple podcast 🎧YouTube Podcast
Dans les coulisses de l'innovation médicale
Qu'est-ce que la pandémie de COVID-19 nous a appris sur l'avenir de la médecine ? Comment la médecine de précision va-t-elle transformer notre approche des soins ? C'est ce qu'explore le Professeur Michel Goldman dans ce nouvel épisode de Healthier Humanity.
Figure majeure de l'innovation médicale en Europe, le Professeur Goldman nous dévoile sa vision d'une médecine en pleine transformation, à l'intersection des disciplines et des technologies.
Immunologiste de formation et premier directeur exécutif de l'Initiative Médicaments Innovants Européenne, il analyse les leçons de la pandémie : "La première leçon scientifique, c'est un rappel. Le rappel que les pandémies existent depuis toujours dans l'histoire de l'humanité." À travers cette analyse lucide, il nous explique l'importance du concept de santé globale (One Health) et pourquoi nous ne sommes pas égaux face aux mêmes agressions virales.
De son côté, le Professeur apporte un éclairage scientifique crucial sur la révolution des vaccins ARNm : "Je pense que c'est une véritable révolution qui s'est mise en marche." À travers son expertise en immunologie, il démontre comment ces vaccins représentent bien plus qu'une simple réponse à la pandémie, mais une transformation profonde de notre approche thérapeutique.
Dans cette conversation riche en enseignements, notre expert partage :
- Les leçons fondamentales de la pandémie COVID-19
- La révolution des vaccins ARNm et leur potentiel contre le cancer
- Les multiples dimensions de la médecine de précision
- Le rôle crucial de l'intelligence artificielle en médecine
- L'importance d'une véritable "Europe de la santé"
Cette discussion démontre que l'avenir de la médecine se construit à l'intersection des disciplines - biologie, physique, informatique, sciences sociales. Que vous soyez professionnel de santé, patient ou simplement curieux des évolutions médicales, cet épisode vous donnera les clés pour comprendre les transformations profondes qui façonnent la médecine du futur.
[EPISODE TRANSCRIPT]
Introduction [00:00]
Jean-Charles : Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Healthier Humanity. Je suis Jean-Charles Samuelian Werve, votre hôte pour ce podcast, où j'interview des experts à renommée mondiale de la santé, des athlètes de haut niveau ou des leaders visionnaires, pour parler de comment, en tant qu'individu, nous pouvons vivre plus longtemps en meilleure santé, de creuser toutes les nouvelles recherches, innovations, sur la longévité et les rendre plus accessibles pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Michel Goldman, qui est une figure majeure de l'innovation médicale en Europe, et on va discuter de la médecine du futur. Immunologiste de formation, Michel a joué un rôle pionnier dans le rapprochement entre recherche fondamentale et application clinique. Il est le premier directeur exécutif de l'initiative Médicaments Innovants Européennes. Il a révolutionné la collaboration entre chercheurs académiques et industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, en tant que fondateur de l'Institut for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, il oeuvre pour accélérer le développement de traitements innovants. Ses travaux récents sur les leçons de la pandémie de COVID-19 pour l'avenir de la médecine ont eu un écho international, ainsi que son livre La médecine d'après. Michel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Michel Goldman: Avec plaisir.
Les leçons de la pandémie [01:32]
Jean-Charles : Rentrons dans le vif du sujet. Tu as publié il y a quelques mois un papier sur les leçons de la pandémie pour le futur de la médecine. Et j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse aux transformations que tu as identifiées. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelles sont les principales leçons scientifiques de cette pandémie ?
Les leçons fondamentales de la pandémie
Michel Goldman : Je dirais que la première leçon scientifique, c'est un rappel. Le rappel que les pandémies, depuis toujours finalement, l'histoire de l'humanité. Je lisais récemment la peste de Camus qui décrit très très bien comment effectivement le bacille de la peste est transmis et je pense que la première leçon c'est vraiment l'importance de ce concept de santé globale, One Health, Global Health et en particulier le rôle des zoonoses dans le développement ou l'émergence des pandémies. Et bon, il y a encore des discussions en cours sur l'origine du Covid-19, mais il y a peu de doute effectivement qu'une zoonose soit à son origine. Et bon, cette question reste d'actualité maintenant avec les craintes liées à la grippe aviaire, la 5N1 et je disais que le premier cas de transmission d'homme à homme venait d'être rapporté et donc encore une fois ça montre les interactions étroites entre le monde animal et notre monde et l'importance de le considérer pour effectivement essayer de prévenir, on y reviendra le mieux possible, les pandémies.
Ceci dit, la deuxième leçon, c'est évidemment que nous ne sommes pas égaux face à la même agression virale. On sait et on a très vite réalisé qu'effectivement, face au virus SARS-CoV-2, les individus obèses, les individus diabétiques, les individus plus âgés étaient particulièrement vulnérables. Et puis, on y reviendra peut-être, on s'est rendu compte que quand même certains individus plus jeunes, à priori qui ne devraient pas développer de maladies graves, le faisaient en raison d'un terrain génétique particulier. Et je pense que ces travaux de Jean-Laurent Casanova notamment ont été excessivement importants pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas effectivement égaux face aux mêmes agressions.
Et puis, bien sûr efficaces et ne vont pas entraîner d'effets secondaires. Alors, il faut quand même rappeler que ces vaccins ARN sont le fruit de plus de dix ans de recherche, que les premiers êtres humains injectés avec ce type de vaccin remontent aussi à plusieurs années. Et donc, on était sur des bases solides. Alors, ce qui a permis d'aller très vite, ça a été... D'une part, disons la connaissance de la séquence du virus. Ici, il faut rendre hommage aux chercheurs chinois qui ont très rapidement, dès la fin 2019, début 2020, effectivement, publier la séquence. Et sur cette base, très rapidement, il était possible de développer un vaccin ARN qui cible la protéine Spike, dont on savait qu'elle était importante parce qu'il y a un virus qui a précédé, qui est le virus SARS-CoV-1. Et là aussi, les connaissances sur ce virus ont effectivement permis d'avancer très vite.
Michel Goldman : Dans les vaccins ARN contre le SARS-CoV-2. Ce qui est assez important à souligner ici, c'est une différence majeure entre ces deux virus. Le virus SARS-CoV-1, lorsqu'on l'avait contracté, eh bien, on tombait très rapidement gravement malade, on devait rester alité, et donc la dissémination du virus finalement, était très limitée. Alors, une des caractéristiques, une leçon importante, finalement, de la pandémie Covid-19, c'est qu'elle a été disséminée par des individus, en fait, qui avaient peu de symptômes ou pas de symptômes du tout. Et ça, c'est évidemment une leçon importante de savoir que chez ces gens qui sont épargnés de tout symptôme, qui mènent une vie normale, ils vont répandre le virus dans la population et ça a été à l'origine de cette pandémie terrible.
Michel Goldman : Alors, un point sur lequel je voudrais aussi insister, qui pour moi était une leçon importante, c'est la recherche unique. Alors, la recherche unique, là, je pense qu'il y a différentes... Différents points qui peuvent être soulignés par rapport à la rigueur indispensable. Et je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, mais ça montre bien qu'il faut être excessivement prudent dans l'interprétation des résultats d'études cliniques, même lorsqu'ils sont rapportés par des figures qui sont connues dans le monde des maladies infectieuses. Et donc, je crois qu'un autre aspect des recherches cliniques, c'est qu'il fallait avancer très, très vite. Et là, il y a eu, entre certaines équipes cliniques, finalement, une compétition assez malsaine qui a fait qu'on n'a pas pu recruter suffisamment de patients dans des laps de temps suffisamment courts pour arriver à des conclusions, disons, fiables.
Dernière leçon, enfin, il y en a beaucoup, mais leçon sur laquelle je voudrais insister, c'est l'importance, lorsque l'on a développé un outil efficace, ce qui a été le cas, évidemment, des vaccins, on estime qu'ils ont sauvé un million et demi de vies rien qu'en Europe, Eh bien, il faut s'assurer que la population a confiance dans ces produits et c'est clair que, disons, la prolifération des messages anti-vax a joué un rôle délétère. On aurait sans doute pu sauver encore plus de vies et là, c'est un point sur lequel on viendra. Ça montre l'importance d'une éducation en santé qui soit correcte pour ne pas laisser la place à ces messages qui ont toujours existé, disons, lorsqu'on s'intéresse aux vaccins.
La révolution de l’ARNm [08:45]
Jean-Charles : Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai envie de creuser. Peut-être pour commencer, et là avec ta casquette d'immunologiste, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ces vaccins à ARNm sont une révolution en médecine et à quel point c'est important, ou en tout cas c'est un moment important dans l'histoire de la médecine ?
Michel Goldman : Je dirais plus, je pense que c'est une véritable révolution qui s'est mise en marche parce que ces vaccins d'abord peuvent être développés très rapidement. Dès que l'on connaît la séquence génétique de l'antigène à cibler, on peut très rapidement développer des candidats vaccins. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que ces vaccins, à l'inverse de la plupart des vaccins disponibles, permettait d'induire à la fois la production d'anticorps, mais aussi avoir une action sur les lymphocytes T. On appelle l'immunité cellulaire, c'est important parce que lorsque l'on pense notamment aux atteintes les plus graves, je pense aux atteintes des poumons, les défenses sont assurées au moins partiellement par ces lymphocytes T. L'autre révolution, qui est un peu liée à ce que je viens de dire, c'est que ces vaccins ARN sont encapsulés dans des nanoparticules lipidiques qui en fait jouent le rôle d'adjuvants. La plupart des vaccins font appel à des adjuvants qui induisent une réponse inflammatoire qui renforce, disons, ou qui permet plutôt d'induire la réponse vaccinale. Il n'y a pas d'adjuvant à proprement parler dans les vaccins ARN, mais le fait qu'ils soient enrobés dans ces... Un nanoparticule lipidique permet à ces nanoparticules, effectivement, de jouer quelque part ce rôle d'adjuvant.
Alors, il faut savoir que dans l'histoire des vaccins ARN, il a fallu, et ça a été à l'origine de prix Nobel, bon, un prix Nobel a couronné effectivement le développement de ces nanoparticules lipidiques, mais aussi on savait que l'ARN n'attendait pas allait entraîner des réactions inflammatoires très importantes. Et donc, c'est la substitution de nucléotides, notamment de l'uridine en pseudo-uridine, qui a permis de limiter ce potentiel inflammatoire des ARN messagers. Et donc, on se demandait quand même, on sait qu'on a besoin d'un adjuvant ou d'une action de type adjuvant. Et on s'est rendu compte qu'elle provenait de ces nanoparticules lipidiques dont le rôle essentiel était finalement au départ de protéger l'ARN de sa dégradation. Donc il y a effectivement différentes avancées qui, on y reviendra peut-être, ont fait intervenir différentes disciplines. Il a fallu des chimistes, des physiciens, bien entendu des immunologistes, des biologistes moléculaires pour effectivement arriver à assembler ces vaccins ARN messagers qui aujourd'hui, je parle de révolution parce que s'ils ont permis effectivement de lutter contre le Covid-19, aujourd'hui ils sont très prometteurs dans l'approche contre le cancer.
La collaboration interdisciplinaire [12:54]
Jean-Charles : J'aimerais beaucoup creuser ce point-là. Tu parles beaucoup, en effet, de l'importance de la collaboration à la fois interdisciplinaire, mais aussi internationale, pour le succès des inventions et des innovations en médecine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage sur quels sont les cas où ça fonctionne bien, où ça ne fonctionne pas bien, et qu'est-ce que ça pourrait permettre ?
Michel Goldman : Bien, alors, ces collaborations, cette intelligence collective qui a permis le développement de ces vaccins ARN-MSG, elle intervient à différents niveaux. D'abord, entre les disciplines. Et je pense que, clairement, la science médicale classique ou biomédicale classique seule n'était pas suffisante pour, effectivement, arriver à développer ces vaccins. On y reviendra peut-être à propos d'autres questions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la médecine doit faire appel à des disciplines qui, malheureusement, ne sont pas encore suffisamment enseignées dans les facultés de médecine.
Alors, les autres collaborations très importantes, et on l'a bien vu à propos des vaccins anti-Covid, c'est entre le secteur public et le secteur privé. Il y a plusieurs exemples. D'abord, l'Université d'Oxford avec... qui a noué ce partenariat avec AstraZeneca. Mais donc, le vaccin est né effectivement dans l'université. Et ces collaborations, disons, publiques-privées, on voit qu'elles sont vraiment essentielles avec chaque partenaire. Et bien entendu, elles sont aussi intervenues dans les vaccins à ARN parce qu'il y a eu toute une recherche financée d'ailleurs par le public qui a permis effectivement l'arrivée de ces vaccins. Je pense que cette collaboration permet finalement de tirer le meilleur parti de ce qui est la force de l'industrie. C'est justement le fait de travailler en équipe, de se préoccuper essentiellement du résultat plus que de se préoccuper de celui ou celle qui est à l'origine de la découverte, disons. Dans le monde académique, malheureusement, les égaux jouent beaucoup, la compétition joue beaucoup, et là, parfois, on a des difficultés à nouer ces collaborations indispensables. Ceci dit, le monde académique a beaucoup d'avantages notamment en termes d'imagination, de créativité des chercheurs. Et c'est pour ça, effectivement, que moi, je plaide beaucoup pour ces partenariats public-privé, industrie-université, qui permettent finalement de combiner les points forts des deux secteurs.
La médecine translationnelle [16:23]
Jean-Charles : Et dans ce contexte-là, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la définition de médecine translationnelle et ce que ça veut dire ? Et pourquoi avoir créé ce terme et qu'est-ce qui se cache derrière ?
Michel Goldman : Je pense que le terme de médecine translationnelle traduit finalement tout le long processus qui va d'une observation expérimentale suggestive d'un nouveau diagnostic ou d'un nouveau traitement. Et bon, les exemples sont nombreux. Et depuis cette première observation, qui peut être faite in vitro, qui peut être faite sur un modèle animal, jusqu'à l'arrivée, disons, dans nos pharmacies, sur le marché, il y a un très long processus qui est nécessaire, qui implique de multiples acteurs, tant académiques qu'industriels qui implique aussi au stade ultime les agences réglementaires. Et donc, tout ce long processus, on peut le qualifier de médecine translationnelle. En fait, on peut anticiper, dès l'observation PRINCEPS, effectivement, quel va être le parcours nécessaire pour développer, prenons l'exemple d'une nouvelle thérapeutique, un nouveau médicament, sachant que ce sera un processus a priori long. Alors, on peut dire qu'il y a une exception, évidemment, fameuse avec les vaccins anti-Covid, mais long et coûteux. En particulier, les dernières phases de l'expérimentation, qui vont précéder l'approbation et la mise sur le marché, ça représente des phases excessivement coûteuses qui nécessitent des investissements importants, qui en général sont assurés essentiellement par le secteur privé, même si, encore une fois, l'exemple des vaccins Covid-19, et là, il faut rendre hommage à l'opération Warp Speed aux États-Unis, qui a montré que le secteur public peut fournir les incitants financiers importants pour effectivement accélérer, disons, l'arrivée de vaccins dans les populations.
Jean-Charles : Et du coup, comment cette approche translationnelle, elle transforme concrètement ces processus qui sont extrêmement longs ? Quelles sont les différences ?
Michel Goldman : Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement un souci, une demande des populations, des décideurs en matière sanitaire, d'accélérer autant que possible ce processus. Et je crois qu'à cet égard, pour l'accélérer, je dirais que les patients, leurs familles ont un rôle très important à jouer. Et lorsqu'on parle, disons, de collaboration indispensable, il faut quand même rappeler que dans la médecine transnationale, il y a plusieurs étapes où... Les patients eux-mêmes interviennent, acceptent effectivement de recevoir des produits dont l'efficacité et la sécurité n'est pas nécessairement prouvée au stade initiaux de la recherche. Et donc, je pense qu'accélérer la médecine translationnelle, c'est sans doute être plus à l'écoute des patients, de leurs besoins, et les faire intervenir assez tôt dans ce processus de passage de l'observation expérimentale au produit final.
L'implication des patients [20:33]
Jean-Charles : Et si là je prends la position du patient, comment... Pour un patient qui a une certaine typologie de maladie ou de diagnostic, comment il pourrait s'informer, comment il pourrait lever la main ou s'impliquer à ces différentes étapes ? Quels sont tes conseils là-dessus pour les patients ?
Michel Goldman : Alors ça, c'est un point important. On revient évidemment aux aspects d'éducation en termes de santé. Lorsque j'étais directeur exécutif de l'Initiative européenne pour les médicaments innovants, on a lancé une académie des patients et effectivement, avec, je dois dire, certaines réticences de la part, notamment de certaines autorités à l'époque, puisque dans cette initiative, le monde pharmaceutique intervient pour moitié et le monde académique pour l'autre moitié. Il y avait des réticences à l'idée de créer effectivement cette académie de patients avec... et que quelque part le soutien de l'industrie pharmaceutique s'est accepté. Ça a très bien marché, ça fonctionne toujours très bien, 15 ans plus tard. Et je crois qu'effectivement, les patients aujourd'hui qui souffrent de maladies graves, qui souffrent par exemple de maladies rares vis-à-vis desquelles on est très démuni, aujourd'hui, qu'on prenne le processus qui peut-être un jour leur permettra de bénéficier d'un traitement efficace et donc ont l'information nécessaire pour exercer finalement sur les différents acteurs la pression nécessaire pour effectivement aller au plus vite tout en étant attentif à ne pas compromettre évidemment la sécurité de ce nouveau traitement ce qui est un élément essentiel.
Jean-Charles : Et donc, dans cette académie pour les patients, on leur apprend à savoir demander l'accélération ou pouvoir être parmi les premiers à tester un nouveau traitement.
Michel Goldman : Oui, on leur apprend d'abord comment se développe un nouveau médicament, comment ils peuvent jouer un rôle actif en influençant effectivement les choix qui sont faits dans les nouveaux médicaments à développer. Et on leur apprend aussi effectivement à interagir avec les différents acteurs publics, privés. Les agences réglementaires aujourd'hui accordent une importance très importante à leur interaction avec les patients.
Les obstacles à la recherche [23:21]
Jean-Charles : Et dans ton expérience, quels sont les autres obstacles entre la recherche fondamentale et les applications cliniques ?
Michel Goldman : Alors, j'aurais... Une seule réponse, finalement, c'est les obstacles financiers. Le coût de l'investigation clinique, en particulier au stade, disons, précède l'acceptation du médicament, sont colossaux. Et en fait, lorsque l'industrie pharmaceutique parle de ses investissements en recherche, eh bien, on peut estimer qu'une bonne partie de ces investissements, pas tous, mais une large partie, en fait, concernent effectivement ces investigations cliniques, ces études à large échelle qui permettent de démontrer l'efficacité et la sécurité. Ceci dit, c'est un élément important, à la fois, on l'espère, pour réduire les coûts de l'investigation clinique, mais aussi accélérer le processus de médecine transnationale que tu évoquais, d'orienter la recherche de manière à aller au plus vite aux résultats que l'on cherche.
Fonctionnement des essais adaptatifs [24:57]
Jean-Charles : Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu plus en détail ? Qu'est-ce que c'est qu'un essai adaptatif ? Et du coup, qu'est-ce que ça permet ? Ça réduit le nombre de personnes sur lesquelles on teste ? Ça permet d'itérer plus vite, c'est ça ?
Michel Goldman : Ça permet, lorsque l'on teste... plusieurs hypothèses thérapeutiques et ça a été beaucoup utilisé dans le cancer, c'est là que ça a été utilisé en première intention. Eh bien, lorsque les premiers résultats apparaissent, ça permet d'abandonner certaines pistes, d'en privilégier d'autres et donc d'aller effectivement plus rapidement à l'essentiel.
La médecine de précision [25:28]
Jean-Charles : Tu mentionnes également que le Covid-19 a souligné l'importance d'approches de soins et d'approches thérapeutiques qui sont adaptées, qui prennent en compte les déterminants individuels. Tu parlais du fait qu'on était parfois inégaux face à ces sujets-là, mais aussi des déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Ça nous amène un peu au sujet de la médecine de précision. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la médecine de précision concrètement et comment elle permet à la fois d'adresser l'hétérogénéité des maladies, mais aussi des patients ?
Michel Goldman : Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut bien voir que pour la plupart des maladies, il y a effectivement plusieurs déterminants essentiels. Il y a effectivement des déterminants génétiques dont on a déjà parlé. Alors bon, pour certaines maladies rares, c'est un gène anormal, mais pour la plupart des maladies, c'est une panoplie de gènes qui, ensemble, vont définir, disons, la susceptibilité d'un patient à une maladie particulière et qui peut être une maladie infectieuse, mais pas seulement. Il y a tout ce qu'on appelle les maladies non transmissibles qui, effectivement, sont excessivement importantes aujourd'hui. Il faut rappeler que les maladies cardiovasculaires sont les pathologies qui tuent le plus aujourd'hui.
Mais donc, à côté de ces déterminants génétiques, il y a effectivement les déterminants de l'environnement. Et ça, je pense que c'est très important d'en tenir compte. Alors, ces déterminants de l'environnement, et que l'on regroupe souvent sous le terme d'exposomes, d'abord, ça va être effectivement notre environnement. On sait que la pollution atmosphérique est effectivement un facteur très important de morbidité. Ça a été vu aussi durant le Covid. On sait que les régions du nord de l'Italie sont victimes d'une pollution importante et ça explique pourquoi la maladie s'y est développée de façon aussi dramatique.
La pollution, l'alimentation, je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a d'autres éléments qui interviennent. On sait aujourd'hui par exemple que le réchauffement climatique va être très important aussi pour le développement de certaines maladies. On sait que la dengue aujourd'hui commence à faire son apparition, y compris dans les régions du sud de l'Europe, y compris en France. Et donc, on sait aussi, pour prendre un autre exemple qui est moins bien connu, que la qualité du sommeil est quelque chose de très important, qui va effectivement influencer la susceptibilité à différentes affections.
Et en fait, pour revenir à la génétique d'une certaine manière, on sait que certaines maladies font intervenir des mutations somatiques, c'est-à-dire des altérations du génome qui apparaissent tout au long de la vie. Il y a des arguments pour penser effectivement que les mauvais dormeurs sont plus sensibles à ces mutations somatiques qui peuvent effectivement favoriser toute une série de pathologies.
Alors ce qui a été aussi important, toujours pour faire le lien avec la génétique, c'est la compréhension que ces facteurs environnementaux influent sur l'expression des gènes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui va être influencée par l'exposome et donc indirectement va modifier la manière dont les gènes vont être exprimés. Et puis il y a un autre facteur qui apparaît aujourd'hui comme excessivement important, un autre déterminant des maladies, qui est le microbiote, qui sont ces bacilles que nous hébergeons notamment à l'intérieur de notre tube digestif, mais aussi au niveau d'autres muqueuses. Et on sait aujourd'hui que la composition de ce microbiote va avoir une influence importante et favoriser certaines maladies, l'obésité, le diabète, aussi certaines maladies hépatiques, les hépatites non-alcooliques qui aujourd'hui représentent un vrai problème.
Et donc tout ça fait qu'on a effectivement différentes manières lorsqu'on est face à un patient, que l'on ait connaissance de sa pathologie ou que l'on vise à prévenir des pathologies qui pourraient survenir, il faut faire effectivement la synthèse de tous ces éléments pour essayer d'être le plus précis possible. Maintenant, le concept même de médecine de précision, je pense qu'il faut rappeler qu'il est né dans le domaine de l'oncologie. Pourquoi ? C'est dans le domaine du cancer qu'on a pu mettre en évidence, disons, les mécanismes moléculaires intimes qui caractérisent chaque cancer.
Aujourd'hui, on sait par exemple que lorsqu'on parle d'une femme qui souffre d'un cancer du sein, on n'a encore rien dit. Il y a sans doute des dizaines de cancers du sein différents qui correspondent à des mutations dans les cellules tumorales différentes. Ces mutations vont avoir toute une série de conséquences qui sont bien identifiées et on va pouvoir les cibler par des médicaments anticancéreux spécifiques. C'est de là qu'est né le concept de médecine de précision qui tend à s'élargir aujourd'hui. C'est ce à quoi j'ai fait allusion en débutant ma réponse.
Mais je pense que finalement, l'objectif, c'est de se dire que des pathologies qui sont qualifiées par le nom du médecin qui les a découvertes, maladies de Crohn, maladies de Parkinson, démence d'Alzheimer, etc. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces maladies ne sont pas univoques, qu'en fait, ce sont plutôt des syndromes dont les causes sont multiples. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit à propos de la génétique, de l'exposome et du microbiote. Et donc, tout le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à disséquer ces maladies, à identifier de nouvelles cibles qui permettent effectivement de traiter différemment des patients qui a priori seraient atteints de la même pathologie, en fait, ils ne le sont pas. Leurs symptômes peuvent être identiques, mais les causes de ces symptômes peuvent être très différentes.
L'exposome et la prévention [33:07]
Jean-Charles : C'est fascinant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser. Du coup, pour rappel pour nos auditeurs, l'exposome, c'est l'ensemble des expositions environnementales auxquelles nous sommes soumis tout au long de notre vie. Comment, en tant que patient, ou pas encore patient d'ailleurs, qui essaie d'essayer de ne pas le devenir, on peut essayer d'agir aujourd'hui sur notre exposome. Est-ce que tu conseilles de connecter ça aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire du séquençage ADN en masse pour mieux se connaître ? Est-ce qu'on devrait tester son microbiote en masse ? Comment tu réfléchis à ces sujets-là ?
Michel Goldman : Je pense que d'abord, il y a des choses assez simples. Je n'ai pas parlé aussi à tous les toxiques qui sont à l'origine de pathologies. Je pense à l'alcool et au... Le tabac, évidemment, on sait aujourd'hui que l'alcool est sans doute une cause plus importante de cancer que le tabac. Et donc, simplement éviter de s'exposer soi-même à des facteurs qui vont favoriser des pathologies parfois graves. Disons, surveiller son alimentation et dès le plus jeune âge, faire en sorte que l'alimentation soit la plus importante, la plus saine possible. Et aujourd'hui, il y a un effort très important qui est fait sur le sucre, comme l'on sait. Et donc ça, ce sont des choses relativement simples. Je dirais aussi éviter les stress inutiles. Le stress est aussi un facteur qui va jouer un rôle important. Ça, ce sont des mesures finalement relativement simples qui peuvent être prises. Alors, pour ce qui est, disons, des méthodes plus sophistiquées, et je pense effectivement au séquençage de l'ADN. Je pense que tout va dépendre du contexte et je pense que c'est vrai que dans les familles où il y a, par exemple, plusieurs cancers, il y a le fameux exemple de ces gènes.
Jean-Charles : BRCA1, BRCA2,
Michel Goldman : cancer du sein, cancer de l'ovaire. Et c'est vrai que si on a dans la famille plusieurs patientes qui en ont souffert, il faut effectivement certainement vérifier, prendre certaines mesures, éventuellement extrêmes, comme Angélina Jolie l'a fait. Il y a un autre... Une autre situation qui est le syndrome de Lynch qui favorise certains cancers colorectaux. Et donc là, effectivement, il y a intérêt à voir si on est porteur du gène favorisant et prendre alors une série de mesures, une surveillance plus étroite.
Intelligence artificielle et médecine de précision [36:04]
Jean-Charles : Excellent. Merci beaucoup pour ce partage-là. Quand on parle de médecine de précision, on imagine aussi du coup un niveau de complexité extrêmement fort. Tu parlais à la fois, il y a beaucoup de données en entrée. Que penses-tu des avancées de l'intelligence artificielle pour nous aider à accélérer la médecine de précision ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment tu penses que ça va se généraliser ? Quelle est ta perspective sur le sujet ?
Michel Goldman : Alors je crois que c'est essentiel parce que pour être plus précis et, disons, tenant compte des causes multiples dont je n'ai évoqué qu'un certain nombre, bien entendu, disons, pouvoir intégrer à la fois les symptômes cliniques, mais aussi des biomarqueurs biologiques qui peuvent être très complexes, ça peut être de la génétique, de la génomique. Ça peut être de la transcriptomique, ça peut être ce qu'on appelle la métabolomique, des métabolites qui s'accumulent en quantité anormale, des protéines anormales qui sont produites, la protéomique, etc., ce qu'on appelle l'éomix.
Et si on veut intégrer tout ça pour mieux comprendre le patient ou celui qui pourrait devenir un patient qu'on a en face de soi, le cerveau humain est juste incapable de faire cette synthèse. Et donc, il est très important que l'on puisse développer des algorithmes, l'intelligence artificielle, pour essayer d'approcher au plus près, finalement, la pathologie dont souffre le patient et secondairement, effectivement, adopter la thérapeutique la mieux adaptée. Ceci étant, l'intelligence artificielle va effectivement permettre de progresser. Elle le fait déjà dans le domaine du cancer. Il faut aussi dire que là-dedans, il faut intégrer les données d'imagerie médicale. Il y a des tas de données que l'on doit considérer.
Ceci étant... L'intelligence artificielle, les algorithmes vont permettre de guider la démarche, mais il sera toujours essentiel de partager les conclusions suggérées par l'intelligence artificielle avec le patient. De manière, et là, on fait le joint entre médecine de précision et médecine personnalisée, parce qu'il restera probablement des choix à faire qui doivent tenir compte des préférences du patient par rapport à sa qualité de vie, par rapport à son espérance de vie.
L'accès à l'information médicale [39:13]
Jean-Charles : C'est vraiment fascinant et ça me pose la question en tant que patient ou juste en tant qu'humain qui se pose des questions sur sa santé. Dans un monde où la recherche avance très vite, et encore une fois, on voit à quel point c'est multidirectionnel entre la génomique, l'exposome, le microbiote, cette médecine de précision, où est-ce que je peux aller chercher de l'information ? Ou si je deviens malade, comment je dois interagir ? Quelles bonnes questions je dois poser à mon équipe médicale ? Comment j'approche ces sujets en tant que patient, selon toi ?
Michel Goldman : Alors là, c'est une question essentielle et ça, disons, permet de dire un mot de ce qu'on appelle la littératie en santé. Évidemment, avec le développement extraordinaire des réseaux sociaux, d'Internet, énormément d'informations circulent et... Très souvent, le patient qui présente des symptômes, avant même de voir son médecin, va consulter Internet, va voir ce qu'il peut trouver. Souvent, il arrive chez le médecin avec sa propre suggestion de diagnostic. Et bon, le médecin est parfois un peu démuni parce que lui, bon, il n'a pas nécessairement connaissance de tout ce qui est apparu sur les réseaux sociaux et peut-être même qu'à certains moments, quelque part, il a du retard par rapport aux connaissances du patient lui-même. Donc ça, c'est un vrai défi. Je pense que ce qui est important, et c'est là que les académies de patients ont un rôle important aussi à jouer, c'est effectivement de faire le tri entre tout ce qu'on peut faire, peut trouver comme informations et essayer de faire en sorte de sélectionner effectivement les informations les plus fiables pour éviter de se perdre dans des hypothèses, s'inquiéter inutilement ou de faire pression sur le médecin pour qu'il oriente sa démarche diagnostique voire thérapeutique, dans le sens que le patient lui-même aurait imaginé après effectivement avoir consulté internet et réseaux sociaux.
L'immunologie et la médecine de précision [41:50]
Jean-Charles : Et si on prend ta casquette d'immunologue, comment la médecine de précision s'applique à l'immunologie ?
Michel Goldman : Alors, bon, elle s'est d'abord appliquée, je dirais, par les anticorps monoclonaux qui permettent de cibler de façon très spécifique, très précise, des antigènes qui peuvent être des antigènes de différentes natures, infectieuses ou pas. Aujourd'hui, les anticorps monoclonaux font partie de la panoplie de traitements contre, je vais prendre un exemple, le virus respiratoire syncytial qui est une menace importante à la fois pour les petits bébés et à la fois pour les individus âgés. On dispose aujourd'hui d'anticorps monoclonaux qui peuvent être effectivement efficaces pour prévenir ce qu'on appelle la bronchiolite du nouveau-né, même si là aussi ces anticorps monoclonaux sont en compétition avec des vaccins.
Ceci dit, les anticorps monoclonaux peuvent cibler toute une série d'autres médiateurs des maladies. Je pense notamment aux cytokines. Les anticorps contre le facteur de nécrose tumorale ont vraiment révolutionné le traitement de l'arthrite rhumatoïde, de certaines maladies inflammatoires du tube digestif et ça continue. On a aujourd'hui de nouveaux anticorps monoclonaux contre d'autres cytokines qui paraissent très importantes et très prometteuses, notamment par rapport à certaines maladies inflammatoires du tube digestif.
Bien entendu, ces anticorps monoclonaux ont été cruciaux pour le développement de l'immunothérapie du cancer. Ces anticorps monoclonaux permettent effectivement à notre système immunitaire de devenir efficace pour éliminer certaines cellules cancéreuses. Il faut savoir que certains cancers vont bloquer nos réponses immunitaires et que des anticorps monoclonaux vont permettre de lever ces freins et de permettre effectivement à notre système immunitaire d'attaquer finalement les cellules tumorales.
Donner un autre exemple que je trouve particulièrement prometteur, c'est ce que l'on appelle les CAR-T cells. C'est finalement une combinaison de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Ça consiste à prélever certaines de nos cellules, en particulier les lymphocytes, et d'y insérer un gène qui va alors permettre à ces cellules de cibler très spécifiquement des cellules anormales, en particulier des cellules tumorales qui expriment un antigène particulier. Pour revenir à la médecine de précision en dehors du cancer, des données toutes récentes montrent que ces CAR-T cells peuvent aussi être des outils thérapeutiques intéressants contre certaines maladies auto-immunes, et en particulier contre le lupus érythémateux disséminé.
Mécanisme des anticorps monoclonaux [46:29]
Jean-Charles : J'ai envie de creuser plein de choses. Pour nos auditeurs qui ont déjà entendu ce mot d'anticorps monoclonaux, mais qui savent exactement comment ça fonctionne, est-ce que tu pourrais expliquer rapidement quel est le mécanisme qui est derrière et à quoi ressemble la prise thérapeutique ?
Michel Goldman : Bien sûr. Donc il faut voir les anticorps comme des structures en Y. Et donc, il y a deux bras à cet Y. Et sur un anticorps normal, ces deux bras sont identiques et permettent effectivement de cibler un antigène particulier. Alors, une fois que cet antigène est ciblé par, disons, l'autre partie de l'anticorps, qui rejoint les deux bras, différents mécanismes peuvent être mis en jeu, notamment l'activation du système du complément qui va permettre de tuer les cellules qui sont reconnues par ces deux bras, mais aussi cette structure commune qui rejoint les deux bras va pouvoir se fixer sur des cellules que nous possédons, qui sont des cellules tueuses, je pense notamment aux cellules tueuses naturelles, et va leur permettre aussi alors d'attaquer effectivement les cellules tumorales. Voilà deux exemples, disons, par lesquels les anticorps monoclonaux peuvent effectivement exercer leur fonction.
Les défis de la médecine de précision [48:08]
Jean-Charles : Super intéressant, je pense que c'est démystifier ces concepts aussi, je trouve que c'est très important. Quels sont, tu penses, aujourd'hui les grands défis et les opportunités de la médecine de précision pour les prochaines années ?
Michel Goldman : Alors, je pense que le plus grand défi, et finalement on a parlé d'avancée, de pathologies pour lesquelles de nouveaux espoirs sont nés, je pense que le plus grand défi, c'est de progresser de la même manière pour les pathologies qui touchent le cerveau, tout ce qui concerne la santé mentale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des anticorps qui ont été développés contre la dépendance d'Alzheimer, leur efficacité, disons, est relative et contestable. Et disons que, de façon générale, il faut bien dire que sur les désordres mentaux, on est assez démuni lorsqu'on pense à des pathologies comme la dépression, finalement, il y a eu très peu de progrès fait au cours des dernières années. Ça tient essentiellement à la complexité du cerveau et de son fonctionnement. Et là, je pense qu'il y a effectivement de nouvelles approches à développer, d'abord pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, et ensuite pour essayer d'identifier les mécanismes intimes qui sont à l'origine notamment des maladies neurodégénératives et de la dépression.
L'avenir de la télémédecine [50:12]
Jean-Charles : On en parle un petit peu de la psychiatrie de précision avec Marion Le Boyer. C'est parfait. Et la connexion aussi avec des réactions inflammatoires dans le passé et des corrélations de problèmes de maladies mentales dans le futur. C'est hyper, très, très intéressant. Avec toutes ces transformations, comment est-ce que tu vois le rôle de la télémédecine dans le futur des soins ?
Michel Goldman : Alors bon, la télémédecine, bien entendu, s'est extraordinairement développée parce qu'on n'avait pas vraiment d'autres possibilités pendant la pandémie du Covid. On s'est rendu compte que pas mal de choses pouvait, disons, être assurée par la télémédecine, d'une certaine manière, mais avec des limites, le dialogue entre le patient et son médecin, la transmission de résultats biologiques, la transmission d'images. Et je pense qu'avec le problème de la désertification médicale, de la pénurie finalement globale de médecins, il est clair que la télémédecine va se développer et que pour certaines spécialités, c'est vraiment une des voies à suivre et à développer. Je pense que, qu'on le veuille ou non, malgré ses limites, elle va permettre de rendre de très grands services.
L'évolution du rôle du médecin [51:12]
Jean-Charles : Et quand on voit un monde où, justement, avec cette médecine de précision, cette personnalisation, le rôle du médecin est à la fois de plus en plus complexe, le niveau de connaissance qu'il va falloir avoir pour être être pertinent et la barre est sûrement de plus en plus haute, avec une recherche qui est de plus en plus globale, qui avance de plus en plus vite. Comment tu vois le rôle des médecins évolués ? Tu parlais du fait que pendant la formation, il y avait un manque d'interdisciplinarité. Comment t'imagines l'évolution de la formation, l'évolution du rôle du médecin dans le monde dans lequel on arrive ?
Michel Goldman : Voilà, donc je crois qu'il est très important que de réaliser que le médecin doit accepter effectivement qu'il a des limites dans ce qu'il peut connaître et dans les synthèses qu'il est amené à faire. Je crois que le travail en équipe avec d'autres disciplines est essentiel. Comme j'explique souvent, le neurochirurgien a besoin d'être guidé en général par un physicien lorsqu'il aborde... Par exemple, une tumeur cérébrale, c'est un des exemples, mais on pourrait les multiplier. C'est clair que le médecin lui-même va devoir reconnaître que non seulement il ne peut pas tout connaître, mais même que face au patient, il a besoin de faire appel à d'autres disciplines. Ça va être quelque chose de relativement compliqué à obtenir parce que disons, traditionnellement, le médecin se sent, disons, investi de la responsabilité totale du diagnostic et du traitement. Et ça va aussi être compliqué parce qu'il va s'agir dans nos facultés, dans nos universités, effectivement, de créer finalement sans doute de nouveaux types de cursus médicaux. Or, on sait que malheureusement, les facultés de médecine, les universités au sens large, en général, font preuve d'un certain conservatisme. Donc, ça ne va pas être facile à implémenter.
La littératie en santé [53:34]
Jean-Charles : Je pense que leur rôle est en effet très dur parce qu'il y a des demandes du système existant. Il faut penser le futur et comment avoir des cursus qui sont déjà très chargés, les faire évoluer. Ce sont des questions qui sont hyper importantes. On avait parlé tout à l'heure et on avait... Touché du sujet de la littératie en santé, j'aimerais en parler encore un peu plus. Comment améliorer la compréhension des enjeux de santé pour le grand public ? Comment lutter contre la désinformation médicale ? Qu'est-ce que tu aimerais voir plus en termes de système ou outils ?
Michel Goldman : Alors pour moi, ce qui est très important, c'est de débuter l'éducation sur les bases de la santé très tôt dans la vie. Dès l'école primaire, et moi-même j'ai fait cette expérience de parler des vaccins dans des écoles avec des élèves qui avaient, disons, entre 10 et 12 ans. Et j'étais étonné du fait qu'ils étaient très intéressés et en fait très réceptifs. Parfois les profs de sciences disent "mais écoutez, ça va être trop compliqué pour eux". Pas du tout, je pense qu'il y a moyen d'expliquer les choses simplement, partaient des maladies infectieuses. Pour donner un exemple, je leur montrais des photos prises dans les années 50 d'enfants qui, disons, devaient céder de différents outils pour marcher parce qu'ils étaient atteints de poliomyélite et je leur disais "Est-ce que vous avez vu des enfants qui doivent céder de ces cannes ou de ces autres outils ?" Ils me disaient non, je leur expliquais qu'ils ne les voyaient pas parce que la poliomyélite, en tout cas dans nos régions, avait disparu grâce à la vaccination. Et puis, je leur montrais des photos prises plus récemment dans des pays comme l'Afghanistan, où la poliomyélite est encore présente. Et de là, je leur expliquais pourquoi il est tellement important, effectivement, de promouvoir la vaccination de façon globale et de permettre effectivement à tous les enfants de bénéficier de ces systèmes de protection. Mais bon, donc ça, c'est pour prendre cet exemple. Mais à cette occasion, j'ai eu pas mal de dialogues intéressants où les enfants eux-mêmes parlaient de pathologies qu'ils rencontraient dans leur famille. J'essayais de leur expliquer d'où venaient ces maladies. Et encore une fois, ils étaient très réceptifs et très intéressés. Et je pense que c'est le bon moment parce que, disons, lorsqu'on vient plus tard, les idées préconçues sont installées, c'est vrai notamment par rapport au vaccin. Je pense beaucoup au fait que finalement cette littératie en santé se bâtit tout au long de l'existence en commençant assez tôt.
Jean-Charles : J'imagine aussi en repensant comment on éduque à l'école, mais aussi certains formats de contenu, comment rendre cette littératie en santé abordable pour tous.
Michel Goldman : Et bon, quand on voit effectivement, bon, moi j'ai une petite fille de 6 ans, quand on voit comment très vite ils apprennent à manipuler effectivement les tablettes et tout ça, je pense qu'il y a vraiment moyen d'utiliser ces outils qu'ils connaissent bien, qu'ils aiment bien, pour effectivement développer de nouveaux programmes qui fassent allusion à ces éléments clés de la santé.
Les risques de futures pandémies [57:22]
Jean-Charles : Je change un peu de sujet, mais pour reconnecter à ce qu'on s'est dit au début, quels sont les risques pour toi d'une nouvelle pandémie globale et comment on se prépare à ça en tant que société ?
Michel Goldman : Alors ça, c'est une question essentielle qui fait l'objet de beaucoup de débats. En fait, le risque existe. Alors, est-ce qu'elle va survenir dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans ? Personne ne peut l'affirmer. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut s'y préparer. Alors, pour s'y préparer, il faut vraiment qu'on apprenne de la pandémie Covid-19, qu'on développe les outils qui permettent de dépister l'émergence d'une pandémie très tôt. Là encore, l'intelligence artificielle a un rôle important à jouer. Beaucoup de nouveaux modèles ont été développés pendant la pandémie, des modèles statistiques, des modèles de bioinformatique, sur lesquels on peut effectivement se reposer pour agir beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficacement.
Le point très important pour la préparation aux pandémies, c'est de ne pas perdre de temps. Et dès qu'effectivement un signal apparaît, de très rapidement le traquer par les outils les plus performants, et encore une fois, on dispose aujourd'hui de différents modèles, et aussi d'essayer d'identifier le plus rapidement possible l'origine, habituellement animale de la pandémie, pour pouvoir effectivement agir en amont. Aussi, pour se préparer aux prochaines pandémies, il est très important qu'on ait en place les infrastructures, notamment pour suivre l'évolution de la pandémie, mais aussi pour développer très rapidement les outils pour la combattre.
Et donc, ces outils, c'est avant tout les vaccins. Et donc là, il est très important qu'on ait des infrastructures en place, non seulement dans les pays riches, dans les pays développés, mais aussi dans les pays pauvres, disons, à un revenu limité, pour qu'effectivement ils puissent eux aussi participer à cette lutte qui est effectivement une lutte globale. Et donc, bon, je pense que cette préparation aux prochaines pandémies, ça fait l'objet de beaucoup d'efforts actuellement dans les pays, mais avec encore pas mal, disons, de questions et de savoir si l'effort qui est fait aujourd'hui est suffisant.
Alors bon, je pense quand même qu'il faut dire que les vaccins, c'est une chose. Il faut quand même dire un mot, je ne l'ai pas fait lorsqu'on a parlé des anticorps monoclonaux, mais ils peuvent aussi cibler effectivement des antigènes infectieux. Et pendant la pandémie, Donald Trump en a bénéficié, on a développé des anticorps monoclonaux contre effectivement la protéine Spike. Donc là aussi, il faut être prêt à les développer dès qu'on a une cible qui est plausible. Alors, je parle de ces anticorps monoclonaux parce que, bon, on a, au début de la pandémie, fait appel au plasma de sujets convalescents, mais disons ça, ça a pas mal de limitations et c'est pour ça que aller beaucoup plus rapidement alors ce plasma contient effectivement des anticorps qui peuvent être protecteurs, aller beaucoup plus rapidement, disons, à des anticorps monoclonaux, bon, on peut être effectivement une voie plus efficace.
Le suivi des pandémies [61:31]
Jean-Charles : Il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup dans ce que tu as mentionné et des questions que ça m'amène. Tu disais qu'on doit traquer ça, l'évolution des pandémies, etc. Qui traque ça de manière claire ? Est-ce que ça se passe dans les laboratoires de recherche, dans les hôpitaux ? Est-ce que c'est les cellules de l'État ? Comment on fait en sorte que cette responsabilité, finalement, soit claire ?
Michel Goldman : Oui, alors je pense que la responsabilité doit être partagée. Je pense qu'il y a effectivement un rôle très important des autorités sanitaires des États, mais elles ont besoin de relais, d'instituts qui, effectivement, implémentent ces stratégies. Et donc là, il y a effectivement un dialogue très important qui doit être mis en place et des infrastructures qui doivent être financées par le public, évidemment.
Les investissements en santé publique [62:22]
Jean-Charles : Quand tu vois les discussions qu'on a par exemple en France aujourd'hui sur le déficit de l'assurance maladie, comment penses-tu qu'on va continuer à arriver à justifier les investissements en tant que société contre des événements à probabilité relativement faible mais très grand impact ? Et quand l'événement est récent, on en a encore la douleur, donc on s'en souvient, mais on voit à quel point les sociétés oublient vite. Comment tu penses, si pendant cinq ans il n'y a pas de nouvelle pandémie, quels seront les arguments pour continuer à investir selon toi ?
Michel Goldman : Alors, ça me donne l'occasion de parler de l'Europe. Je pense que ça ne doit pas se passer seulement au niveau de chaque État. Je pense que ça doit faire partie d'une stratégie globale. Pour l'Europe, on parle beaucoup d'une Europe de la santé. Je pense qu'elle doit voir le jour. Et je pense que c'est à ce niveau-là, effectivement, que des efforts doivent être consentis. Et l'Europe de la santé a quand même montré qu'elle peut être efficace quand on pense à ces précommandes de vaccins qui ont permis d'offrir l'accès au vaccin Covid finalement à tous les membres de l'Union européenne dans des conditions, disons, soutenables. On voit qu'effectivement, se mettre ensemble, c'est sans doute la voie à suivre à la fois pour ce que je viens d'évoquer et pour la préparation aux futures pandémies. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les populations devraient comprendre plus facilement si on en fait un objectif majeur à l'échelon, effectivement, européen plutôt que de chaque État.
L'Europe de la santé et ses acteurs [64:15]
Jean-Charles : Essayons de pousser en effet ensemble une Europe de la santé. Pour ça, il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui opèrent dans plusieurs pays, et là, du côté peut-être du privé aussi, du public, pour comprendre les différents systèmes de santé et arriver à faire la connexion entre eux, j'imagine.
Michel Goldman : Alors ça, c'est effectivement un grand défi. Donc il y a l'Agence européenne du médicament, où une connexion est faite quand même avec des représentants de chaque État. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le remboursement des médicaments, les choix qui sont faits en matière financière selon les difficultés budgétaires de chaque État. Et là, disons, il y a des efforts qui sont faits dans ce qu'on appelle "Health Technology Assessment" pour effectivement évaluer les... Les coûts-bénéfices de médicaments, de thérapeutiques ou même de diagnostics, de voir s'il y a une logique à les rembourser. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une disparité importante entre les États, à la fois entre ce qui est accepté au remboursement et ce qui ne l'est pas, mais aussi dans les délais entre le moment où, disons, un nouvel outil devient disponible et le moment où il est pris en charge par la Sécurité sociale.
Jean-Charles : On pourrait imaginer un... Quelque chose de similaire à l'aéronautique, où il y a l'EASA au niveau européen qui stipule les normes aéronautiques, et après les aviations civiles locales qui les appliquent.
Michel Goldman : Oui, mais disons, ici on est à un autre niveau, c'est celui du remboursement, de la prise en charge. Et là, je voyais en Angleterre, ils sont très stricts, au Royaume-Uni ils sont très stricts par rapport à ça. Ils se rendent compte que finalement, des investissements importants qui ont été faits, c'est ce qu'on appelle l'organisation NICE qui s'occupe de ça, n'ont peut-être pas eu l'impact attendu. Et ils plaident le fait que finalement, ces investissements importants qui n'ont pas eu l'impact attendu ont peut-être privé d'autres malades, d'autres traitements qui auraient pu être développés avec les ressources qui ont été investies.
Le paradoxe des ressources en santé [66:38]
Jean-Charles : Oui. C'est souvent un des grands paradoxes de la santé. On aimerait que ce soit un élément à ressources illimitées, mais en fait, c'est un jeu à somme nulle où on doit allouer une quantité finie d'investissement pour un nombre de patients et de maladies. Alors que quand on prend chacun individuel, on pourrait vouloir les traiter à l'infini.
Michel Goldman : Oui, maintenant, il faut aussi tenir compte des économies que l'on fait lorsque... On arrive à guérir quelqu'un qui, sinon, serait en invalidité permanente à charge de l'État.
Conclusion [67:11]
Jean-Charles : Tout à fait. Il faut cette équation complètement globale. Et on revient à une des parties de One Health ou Global Health que tu mentionnais en introduction. Merci beaucoup pour cette conversation, Michel. Est-ce que tu aurais un dernier message de clôture que tu aimerais partager à nos auditeurs sur le futur de la santé ?
Michel Goldman : Le message principal que j'aurais sur le futur de la santé, c'est que... Chacun doit se considérer comme étant un partenaire, un élément important, ne pas se fier uniquement à l'environnement sanitaire, mais se préoccuper soi-même de sa santé et de faire en sorte qu'on agisse le plus vite possible. Et parfois, il y a des moyens relativement simples pour effectivement se prémunir de conséquences qui, à long terme, peuvent être très graves. Et finalement, on en revient au concept qu'allonger la vie, c'est bien, mais le plus important, c'est de vieillir en bonne santé.
Jean-Charles : Un immense merci pour ton expertise, la manière dont tu as approché ces sujets de pandémie, de médecine de précision. J'ai adoré cette notion d'Europe de la santé, à la fois la relation entre des patients avec leur propre santé et l'avenir du rôle du médecin. Donc un immense merci pour cette approche claire, didactique de la médecine du futur qui va reposer entre l'interconnexion de plein de disciplines. C'était passionnant. L'innovation médicale est vraiment un effort collectif entre chercheurs, médecins, industriels, patients pour créer une nouvelle médecine plus équitable, plus efficace.
Michel Goldman : Merci à toi et bon vent à Alan. Et merci encore de l'invitation. Ce fut vraiment un plaisir de discuter avec toi.
Jean-Charles : Avec joie. Merci.
Mis à jour le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
Mis à jour le
3 avril 2025
Une inscription en quelques instants.
Une satisfaction de tous les instants.
92% de nos membres déclarent être satisfaits ou très satisfaits par Alan (mai 2025).